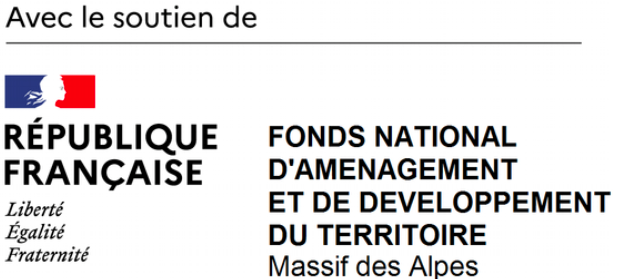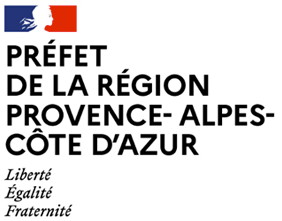La rencontre des forces
Au cœur du massif du Vercors, le site d’Ambel témoigne d’une longue histoire de confrontations des forces géologiques, climatiques et humaines. Les plissements de la croûte terrestre provoqués par la collision des plaques tectoniques a fait naître ici un paysage où se côtoient verticalité des falaises et horizon dégagé des prairies à vocation pastorale. Autre élément structurant, le climat a une forte influence sur l’environnement (le sol, les arbres…). Ce climat montagnard est rude en hiver. Deux vents y dominent : le vent du nord (la Bise) qui procure un froid vif et sec ; et le vent tempétueux du sud qui souffle en rafales provoquant la fonte des neiges. Le plateau d’Ambel, qui appartient au chaînon préalpin du Vercors, est exposé au trajet des dépressions océaniques. Les précipitations peuvent être abondantes et les orages violents. Le brouillard représente un élément caractéristique créant des ambiances parfois mystérieuses. Avec l’altitude, la durée du froid s’allonge sur 6 mois. La température s’abaisse, et surtout la neige et le vent s’intensifient. Ce n’est qu’à la belle saison, de mai à octobre, que l’ensemble du cycle végétal se développe.

Ambel, paysage de diversité et de conflits
Pendant la dernière glaciation, la limite supérieure de la forêt d’Ambel s’est abaissée plus bas que le plateau, vers 1 200 m. Le plateau était alors recouvert de pelouses alpines. Dans les millénaires suivants, le climat continue à se réchauffer : la sapinière et la hêtraie recouvrent Ambel. L’essence largement dominante et la plus exploitée reste le hêtre accompagné des sapins et des érables. La présence de gros arbres, vieux de plusieurs siècles, donne à la forêt d’Ambel une valeur patrimoniale. Ces arbres remarquables dont la structure tortueuse est le résultat des rudes conditions climatiques, ont échappé à la cognée* des charbonniers, leur diamètre rendant leur abattage trop difficile. Durant le Moyen Âge, l’homme a aussi modelé les paysages du plateau. L’exploitation des ressources d’Ambel entraîne de véritables conflits au sommet entre les partisans des forêts et ceux des alpages, comme en témoignent plusieurs procès au cours des siècles. Au cœur des intérêts de tous, paysans, chartreux et seigneurs se disputent la propriété et l’exploitation d’Ambel jusqu’à la Révolution française.
*La cognée est un outil de la famille des haches et servait principalement pour abattre les arbres et fendre les bûches.

Une diversité faunistique
La forêt d’Ambel et le plateau abritent une grande richesse faunistique variable selon les secteurs. On y observe le Cerf élaphe*, le Chamois mais aussi de nombreuses espèces d’oiseaux dont des espèces rupestres telles que le Crave à bec rouge, le Chocard à bec jaune, le Faucon pèlerin, l’Aigle royal ou encore le Martinet à ventre blanc. Dans les alpages et les pelouses d’altitude, sont aussi présents le Traquet motteux, l’Alouette des champs et le Pipit des arbres. Il n’est pas rare de rencontrer d’autres espèces forestières comme la Mésange noire, le Grimpereau des jardins, le Roitelet à triple bandeau, le Pic noir, la Bondrée apivore, la Chouette hulotte et la Nyctale de tengmalm. Sur l’ensemble du site, sont aussi très présents le Faucon crécerelle et le Vautour fauve. Chez les ornithologues, le site est une référence nationale importante pour observer plusieurs dizaines de milliers d’individus d’oiseaux migrateurs, notamment les Hirondelles rustiques et de fenêtre. Le col de la Bataille est un lieu privilégié pour la migration des oiseaux et chiroptères (chauves-souris) particulièrement étudiés. Son orientation est favorable à leur passage et le col, bien marqué, permet aux oiseaux de passer en bas de site lorsque le vent souffle du sud. L’automne est la période la plus favorable à l’observation de la migration post-nuptiale. 90 espèces, surtout des passereaux, ont été observées.
* la forêt d’Ambel est particulièrement appréciée par les Cerfs élaphe au moment du brame.

La flore du plateau d’Ambel
L’immensité des pâturages et les bosquets de hêtres du plateau d’Ambel abritent une flore variée*. L’altitude, la variété des milieux et la diversité des influences climatiques créent une grande richesse botanique avec de nombreuses espèces. Au printemps, des champs multicolores de Jonquilles, de Gentianes, de Crocus, de Narcisses des poètes et de Nivéoles de printemps constituent de véritables tableaux floraux. Plantes toxiques pour les animaux, les colonies de Vératres blancs se multiplient très vite alors que l’Ail des ours aux vertus médicinales colonise les sous-bois. Rare et protégée, la Gagée jaune fleurit à la fin de l’hiver dans un milieu humide et frais. Le Vercors est également célèbre pour son grand nombre d’espèces d’orchidées, parmi lesquelles l’Orchis sureau, "le caméléon des prairies", pourpre ou jaune pâle, qui fait son apparition d’avril à juillet.
* Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes, la cueillette est interdite.

Une histoire humaine à Ambel
Le plateau d’Ambel est un territoire façonné par l’homme au cours des siècles. Dans un contexte de réchauffement climatique, le chasseur du mésolithique parcourt la montagne en quête de ressources naturelles pour se fixer de façon permanente. Au Moyen Âge, les communautés paysannes du piémont d’Ambel utilisent le plateau pour le fourrage et l’estive des troupeaux en altitude. Au 12e siècle, une abbaye cistercienne est installée dans le val de Léoncel ce qui favorise l’exploitation des alpages par les troupeaux transhumants. De grandes figures ont marqué ce territoire par leur dynamisme agricole, notamment la famille Labretonnière et leur fermier, Jules Barraquand. Ce dernier relance l’ancienne race de cheval du Vercors, dite aussi "race Barraquand". Dans les années 1920, la famille Barraquand est à la tête d’un empire pastoral associant les plateaux d’Ambel et de Font d’Urle.

Longtemps, la forêt a été utilisée comme réserve de bois pour l’usage domestique. Les charbonniers et les bûcherons ont également fréquemment occupé ce secteur. Au 18e siècle, la forêt est exploitée de façon plus systématique pour alimenter en charbon de bois les métallurgies du Royans et en grumes les scieries alentour. L’histoire du plateau d’Ambel ne s’arrête pas là. Plus récemment, le premier maquis du Vercors, constitué essentiellement de réfugiés polonais puis de réfractaires au STO, s’installe en décembre 1942 à la Chomate (la ferme d’Ambel), sous le couvert d’une exploitation forestière. Le monument d’Ambel, œuvre du sculpteur valentinois Gaston Dintrat, rappelle ce "premier maquis de France" (Au départ du refuge de Gardiol, des parcours thématiques sont proposés sur les maquisards, mais aussi sur le pastoralisme, la flore, le cerf, le métier de forestier…).

Ambel, espace naturel sensible
Afin de préserver ce site exceptionnel, le Département de la Drôme acquiert dans les années 1950, 1231 hectares au cœur du massif du Vercors. Aujourd’hui espace naturel sensible (ENS), le plateau d’Ambel est reconnu pour sa valeur paysagère, écologique et emblématique. Il fait l’objet d’une gestion concertée avec les services départementaux et les usagers. Sur le terrain, des écogardes départementaux sont présents pour l’accueil et la surveillance du site.